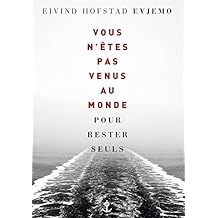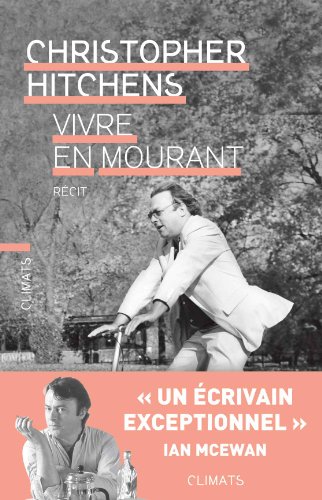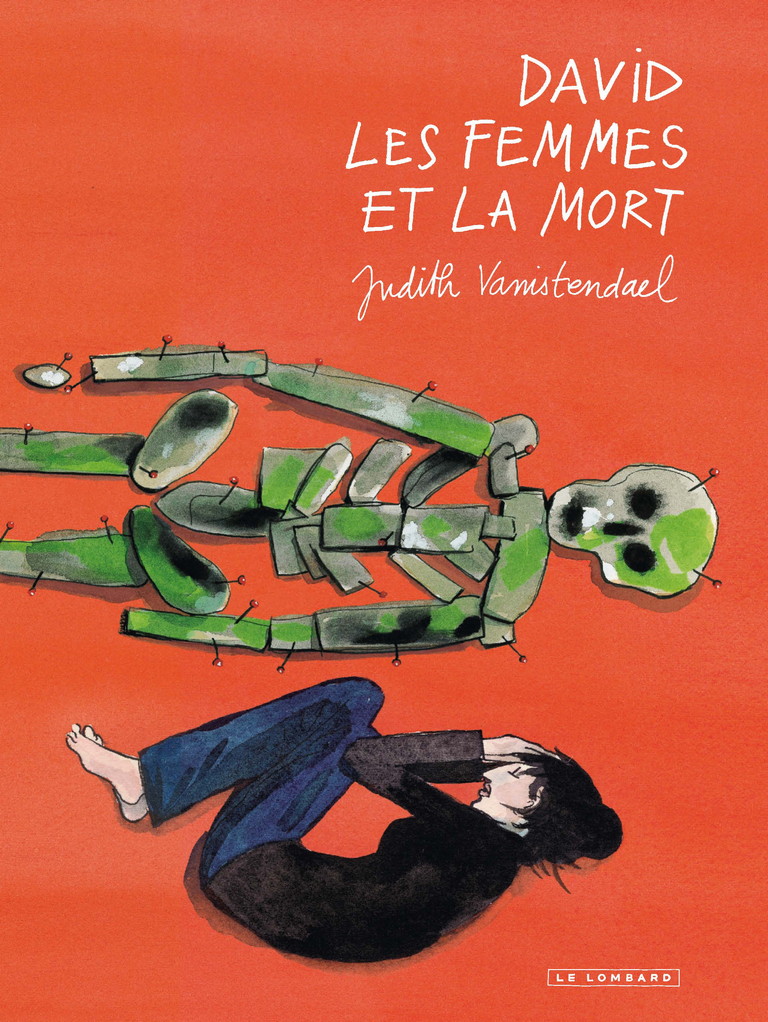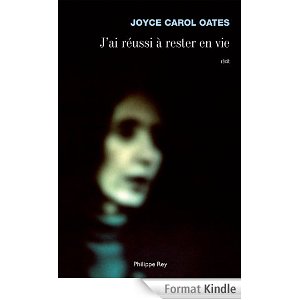Listes des nouveaux livres disponibles
- Aimer, perdre et grandir, Jean Montbourquette
- Ces trous dans ma vie, Isabelle Fable
- Journal d’un amour perdu, Eric-Emmanuel Schmitt
- Carnet de deuil, Nathalie Hanot
- Sur le chagrin et le deuil, Elisabeth Kubler-Ross – D. Kessle
- Deux petits pas sur le sable mouillé, Anne-Dauphine Julliand
- Le berceau vide, deuil périnatal et travail du psychanalyste, Marie-José Soubieux
- Le fils, Michel Rostain
- La rupture de contrat, Anne Givaudan
Liste des livres disponibles sur simple demande
Deuil : Généralités
Vivre le deuil au jour le jour Dr Christophe Fauré
100 réponses aux questions sur le deuil et le chagrin Nadine Beauthéac
Parlons du deuil Ginette Raimbault
Vivre le deuil en famille Rosette Poletti/Barbara Dobbs
100 idées pour éclairer le chemin du deuil Marie-Louise Dufacq-Moreau
Pour dépasser le deuil Sophie Delval
Le deuil du conjoint Anne Liu
La mort d’une mère Hope Edelman
Vivre après ta mort Dr Alain Sauteraud
Comment j’ai vidé la maison de mes parents Lydia Flem
Je vous écris Anny Duperey
Le voile noir Anny Duperey
Ceci est ton corps Gabriel Ringlet
La grâce des jours uniques Gabriel Ringlet
Suicide
Après le suicide d’un proche Dr Christophe Fauré
A Juliette Fabienne Le Clauze
Les fils ne doivent pas mourir Max Derthy
Avec toutes mes sympathies Olivia de Lambertie
Perte d’un enfant
Gaspard, entre terre et ciel Marie-Axelle et Benoît Clermont
Ma fille, mon ange, mon étoile filante Sylvie Veilleux-Deschenes
Parents en deuil Daniel Oppenheim
Surmonter la mort de l’enfant attendu Elisabeth Martineau
Camille mon envolée Sophie Daull
L’été d’Agathe Didier Pourquery
Parler de la mort aux enfants, fratrie et jeunes en deuil
Moi, on ne m’a jamais demandé comment j’allais…Marie Fugain
Les questions des petits sur la mort Marie Aubinais
Le deuil, Y’a pas de mal à être triste Michaelene Mundy
La rose a disparu Sylvie Sarzand, Grégoire Mabire
Même pas sommeil Sylvie de Mathuisieuls, Sabine Pied
La traversée des pays du deuil Muriel Derome
Lothar dans le grand cycle Juliette Grégoire, M. Diacoyannis
Où es-tu parti ? Laurence Afano
Journal d’un amour perdu
Eric-Emmanuel Schmitt
Pendant deux ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d’apprivoiser l’inacceptable : la disparition de la femme qui l’a mis au monde. Ces pages racontent son « devoir de bonheur » : une longue lutte, acharnée et difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l’humour, le culte de la joie.
Ce texte explore le présent d’une détresse tout autant que le passé d’un bonheur, tandis que s’élabore la recomposition d’un homme mûr qui n’est plus « l’enfant de personne ». Éric-Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à l’universel à force de vérité personnelle et intime dans le deuil d’un amour. Il parvient à transformer une expérience de la mort en une splendide leçon de vie.
Avec toutes mes sympathies
Olivia de Lamberterie
Les mots des autres m’ont nourrie, portée, infusé leur énergie et leurs émotions. Jusqu’à la mort de mon frère, le 14 octobre 2015 à Montréal, je ne voyais pas la nécessité d’écrire. Le suicide d’Alex m’a transpercée de chagrin, m’a mise aussi dans une colère folle. Parce qu’un suicide, c’est la double peine, la violence de la disparition génère un silence gêné qui prend toute la place, empêchant même de
se souvenir des jours heureux.
Moi, je ne voulais pas me taire.
Alex était un être flamboyant, il a eu une existence belle, pleine, passionnante, aimante et aimée. Il s’est battu contre la mélancolie, elle a gagné. Raconter son courage, dire le bonheur que j’ai eu de l’avoir comme frère, m’a semblé vital. Je ne voulais ni faire mon deuil ni céder à la désolation. Je désirais inventer une manière joyeuse d’être triste.
Les morts peuvent nous rendre plus libres, plus vivants. »
Ils sont célèbres, artistes, écrivains, créateurs, aimés par un large public. Ils ont foi dans la vie mais la mort les accompagne. Ils y ont été confrontés très jeunes, certains à celle de leurs parents, d’autres à celle d’un enfant. Ils ont assisté aux derniers instants d’un proche, à la fin brutal d’un être cher, d’une compagne ou d’un ami. Ils en ont gardé des blessures, des fragilités, ils ont mûri des réflexions sur le sens de leurs vies privilégiées mais finalement semblables aux autres. Pour la première fois, quatorze personnalités se confient sur la disparition, l’absence, la douleur, l’énigme, le réconfort, leurs croyances, et racontent ces moments où tout bascule. Pour en ressortir plus fort. Quatorze témoignages sans artifices dans lesquels la vie reste malgré tout le fil conducteur.
A la fin du mois d’août 2001, alors que je suis installée dans mon bureau, au premier étage de la maison d’édition où je travaille, ma vie bascule. Littéralement, elle tombe par terre. ” Finie, l’assurance aveugle de durer toujours. Finis, le jeu social et ses divertissements. Fini, le confort d’une société construite par et pour ceux qui vont bien. Est-ce la fin de tout ? Non. Car dans l’expérience extraordinairement violente qui consiste à affronter l’idée de sa propre disparition, on apprend beaucoup. Sur la force des instants. Sur le courage et la fragilité. Sur les puissances de l’amitié. Et sur notre capacité à rire. De tout. La vie est une maladie mortelle. Mais c’est la vie. Marie Desplechin et Lydie Violet ont écrit ce livre ensemble, pendant de longs mois, sans certitude de jamais le terminer. Ni entretien, ni témoignage, ni récit à deux voix, c’est, à force d’écoute et de partage, un livre où le ” je ” qui s’exprime est celui d’un seul auteur.
Le 22 juillet 2011, un véhicule explosait dans le centre d’Oslo, faisant huit morts ; deux heures après, Anders Breivik massacrait soixante-neuf personnes, des jeunes pour la plupart, sur l’île d’Utøya.Une semaine plus tard, une voiture s’avance dans la petite ville de Foldnes. Sella sort de chez elle pour observer le retour de ses voisins : la mère au volant, le père à côté, les deux garçons à l’arrière et une place restée vide. Ils rentrent chez eux sans leur fille, leur sœur, assassinée sur l’île. Sella et son mari vivent depuis plusieurs années près de cette famille qu’ils connaissent assez peu. Mais à présent, Sella a la sensation qu’ils partagent quelque chose, une forme de fraternité qui rassemble le peuple norvégien et en particulier les parents ayant perdu un enfant… Au fil du texte, nous découvrons l’histoire d’Arild et Sella, leur rencontre, leur emménagement, leurs difficultés à concevoir un bébé. Puis l’adoption de Kim, un jeune Philippin qui, malgré l’amour et la tendresse de sa mère adoptive, entretient avec elle une distance glaciale, parfois violente. À 18 ans, Kim décide de partir sur les traces de ses parents biologiques ; il ne reviendra pas, tué au cours d’un attentat près de Manille. Sella est dévastée. Elle aimerait être présente pour ses voisins aujourd’hui, mais peut-on réellement être solidaire de la douleur de l’autre ?Vous n’êtes pas venus au monde pour rester seuls interroge le sens du deuil collectif et confronte perte intime et perte par procuration. La langue incisive d’Evjemo installe une atmosphère hyperréaliste au service d’une histoire dont le terrorisme n’est pas l’objet mais le cœur, d’une fiction sur l’état de nos sociétés post-attentats. Un texte important, puissant.
Winter is coming

Mes mille et une nuits. La maladie comme drame et comme comédie, de Ruwen Ogien, Albin Michel, 256 p., 19 €.
Finalement, Ruwen Ogien n’avait rien à prouver. Quand il a commencé à écrire ses Mille et une nuits, le philosophe pensait signer un essai contre le « dolorisme », cette idéologie qui pare la maladie de vertus rédemptrices (c’est bien connu, souffrir rend meilleur, souffrir nous élève, mais oui) pour fustiger l’hypocrisie des bien-portants comme d’autres celle des bien-pensants. Or, chemin faisant, Ruwen Ogien a pris une tout autre direction. Il a peu à peu abandonné la spéculation sur les enjeux moraux de la maladie, il a renoncé à bâtir une réfutation, ou une thèse, et même à développer un discours aux prétentions universelles. Plutôt qu’une méditation métaphysique, il s’en tient alors à une description brute de la vie meurtrie, la sienne, rongée par un cancer du pancréas.
Délaisser les arguments et le sens, « redescendre sur le sol de la souffrance physique sans justification existentielle grandiose » : on imagine aisément l’effort qu’un tel renoncement a exigé de la part de cet homme d’idées si agile, si fécond et parfois si provocateur, auteur de nombreux ouvrages consacrés à des sujets variés et parfois insolites. Citons, entre autres, L’Influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale (Grasset, 2011), L’Ethique aujourd’hui (Gallimard, 2007), Penser la pornographie (PUF, 2003 et 2008) ou encore Un portrait logique et moral de la haine, paru en 1993 aux éditions de l’Eclat et que cette précieuse maison vient de republier en poche (94 p., 5 €).
La suture
Sophie Daull
Sophie Daull a l’art de raconter des vies qui fuient et des destins qui déraillent. Celle de sa fille, Camille, disparue à l’âge de 16 ans. De sa mère, Nicole, assassinée à 45 ans. De la courte vie de Camille, elle sait tout. Des vingt-six premières années de celle de Nicole, elle ignore presque tout. Après la mort de sa fille, elle avait écrit un premier livre lumineux, Camille, mon envolée, à placer quelque part au côté de L’Enfant éternel, de Philippe Forest. Pour son deuxième, elle est allée à la recherche de Nicole, munie de quelques maigres indices tenant dans une boîte à chaussures comme dans tout bon roman classique. De là va naître une quête minutieuse en forme de road-movie à travers la France profonde. De Coulommiers à Contrexéville, de Belfort au ballon d’Alsace, Sophie Daull déploie son sens du mot juste et de la phrase qui nous touche. Une fiction-reconstitution où elle tire l’aiguille des souvenirs pour aller jusqu’au bout de la suture qui relie mère et fille, et n’est jamais aussi juste que lorsqu’elle remplit elle-même les vides d’un passé recomposé. Comme elle l’écrit joliment, cette quête, « ça me fait durer sans elles, ça me les garde au chaud ». Et ça fait du lecteur le témoin attentif d’une touchante généalogie des sentiments. —
Camille mon envolée
Sophie Daull
Dans les semaines qui ont suivi la mort de sa fille Camille, 16 ans, emportée une veille de Noël après quatre jours d’une fièvre sidérante, Sophie Daull a commencé à écrire. Ecrire pour ne pas oublier Camille, son regard “franc, droit, lumineux”, les moments de complicité, les engueulades, les fous rires ; l’après, le vide, l’organisation des adieux, les ados qu’il faut consoler, les autres dont les gestes apaisent… Ecrire pour rester debout, pour vivre quelques heures chaque jour en compagnie de l’enfant disparue, pour endiguer le raz de marée des pensées menaçantes. Loin d’être l’épanchement d’une mère endeuillée ou un mausolée – puisque l’humour n’y perd pas ses droits -, ce texte est le roman d’une résistance à l’insupportable, où l’agencement des mots tient lieu de programme de survie : “la fabrication d’un belvédère d’où Camille et moi pouvons encore, radieuses, contempler le monde”.
Sophie Daull est née dans l’est de la France. Comédienne, elle vit à Montreuil et travaille partout. Camille, mon envolée est son premier roman.


La plus que vive
Christian Bobin
Ghislaine est décédée à 44 ans d’une rupture d’anévrisme. Par delà l’indicible de la perte, la voix de l’écrivain s’élève, laissant éclater le silence et la puissance des mots. S’adressant à la femme aimée et disparue, Christian Bobin nous dit la jeunesse éternelle de Ghislaine. L’écriture est minutieuse, procède par petites touches et se fait l’évocation d’instants passés, d’émotions toujours vives. Ce sont ces fragments qui peu à peu reconstituent l’image de Ghislaine, dressent son portrait. Christian Bobin ne cède pas à sa tristesse, car “dessous les larmes il y a un rire, comme dessous la neige blanche il y a les roses rouges” et nous livre sa solitude, un silence incarné, habité par une femme, par son image, plus que vive.
Noireclaire
Christian Bobin
C’est si beau ta façon de revenir du passé, d’enlever une brique au mur du temps et de montrer par l’ouverture un sourire léger. Le sourire est la seule preuve de notre passage sur terre.”
Psaumes balbutiés. Livre d’heures de ma mère
A travers sa propre expérience de la maladie, Claire Marin dit la souffrance du malade, sa perte d’identité face à des médecins qui ne voient plus qu’un corps, des symptômes au détriment de l’humain. Elle dit l’urgence à vivre l’instant présent quand tout devient plus fugace. Elle observe sa propre érosion, à 25 ans, contenant en elle un sentiment de colère et d’injustice face à cette maladie chronique, incurable, qui rythme sa vie. Elle dit la frustration du malade, condamné à être incompris, car la douleur ne se décrit pas, ne se partage pas, elle est propre à chacun, solitaire et dévastatrice. Elle dit l’espoir comme le désespoir et la lutte nécessaire pour ne pas finir dévoré par soi-même.
La plume de l’auteur est percutante, incisive. Elle a recours à des phrases chocs, qui trouvent un écho chez le lecteur et frappent par leur pertinence et leur justesse. Un texte fort, glaçant, qui décrit la maladie dans ce qu’elle a de plus concret. Les symptômes physiques et les conséquences psychologiques sont analysés avec le plus grand sang-froid. Un texte effrayant de réalisme et de lucidité, porté par une écriture clinique, qui nous montre la maladie vue de l’intérieur. Un témoignage passionnant et un titre bien choisi qui illustre parfaitement la position du patient, sa colère comme sa déshumanisation !

Sarinagara signifie cependant. Ce mot est le dernier d’un des plus célèbres poèmes de la littérature japonaise. Lorsqu’il l’écrit, Kobayashi Issa vient de perdre son unique enfant : oui, tout est néant, dit-il. Mais mystérieusement, Issa ajoute à son poème ce dernier mot dont il laisse la signification suspendue dans le vide.
L’énigme du mot sarinagara est l’objet du roman qui unit trois histoires : celles de Kobayashi Issa (1763-1827), le dernier des grands maîtres dans l’art du haïku, de Natsume Sôseki (1867-1916), l’inventeur du roman japonais moderne, et de Yamahata Yosuke (1917-1966), qui fut le premier à photographier les victimes et les ruines de Nagasaki. Ces trois vies rêvées forment la matière dont un individu peut parfois espérer survivre à l’épreuve de la vérité la plus déchirante.
Loin des représentations habituelles du Japon, plus loin encore des discours actuels sur le deuil et sur l’art, dans la plus exacte fidélité à une expérience qui exige cependant d’être exprimée chaque fois de façon différente et nouvelle, le texte de Philippe Forest raconte comment se réalise un rêve d’enfant. Entraînant avec lui le lecteur de Paris à Kyôto puis de Tôkyô à Kôbe, lui faisant traverser le temps de l’existence et celui de l’Histoire, ce roman reconduit le rêveur vers le lieu, singulièrement situé de l’autre côté de la terre, où se tient son souvenir le plus ancien : là où l’oubli abrite étrangement en lui la mémoire vivante du désir.

“Le coeur de Simon migrait dans un autre endroit du pays, ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d’autres provinces, ils filaient vers d’autres corps”. “Réparer les vivants” est le roman d’une transplantation cardiaque. Telle une chanson de gestes, il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en vingt-quatre heures exactement. Roman de tension et de patience, d’accélérations paniques et de pauses méditatives, il trace une aventure métaphysique, à la fois collective et intime, où le coeur, au-delà de sa fonction organique, demeure le siège des affects et le symbole de l’amour….

Comme ses Cinq méditations sur la beauté, ce texte de François Cheng est né d’échanges, auxquels le lecteur est invité à devenir partie prenante. Il entendra ainsi le poète, au soir de sa vie, s’exprimer sur un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Le voici se livrant comme il ne l’avait peut-être jamais fait, et transmettant une parole à la fois humble et hardie.
François Cheng n’a pas la prétention de délivrer un « message » sur l’après-vie, ni d’élaborer un discours dogmatique, mais il témoigne d’une vision de la vie. Une vision en mouvement ascendant qui renverse notre perception de l’existence humaine, et nous appelle à envisager la vie à la lumière de notre propre mort. Celle-ci, transformant chaque vie en destin singulier, la fait participer à une grande aventure en devenir.
Juste avant
Fanny Saintenoy
Juste avant de disparaître, juste avant de continuer à vivre: voici le bouleversant portrait croisé d’une très vieille dame sur son lit de mort, Juliette, et de son arrière-petite-fille Fanny, bousculée par la vie moderne. Avec leurs deux récits qui alternent en courts chapitres, cinq générations s’observent, un siècle s’écoule: les orteils de Juliette enfant tombent congelés pendant la Première Guerre, le jeune mari Louis, résistant communiste, tombe pendant la Seconde Guerre. Une seule fille naît, c’est une rêveuse impénitente, et elle tombera d’un cancer à tout juste cinquante ans. Elle élèvera une fille sans mari, Martine, l’instit’ hippie, obsédée par les voyages à l’autre bout du monde. Et enfin Fanny, la trentenaire paumée qui a donné naissance à Milena.
Face aux duretés de la vie, face à la mort qui sème la zizanie, ces femmes gardent une gaieté indéfectible. Ce texte qui alterne poésie douce et drôlerie franche charme par sa maitrise et sa simplicité
Voici un texte qui alterne poésie douce et drôlerie franche.
Par la voix d’une très vieille dame sur son lit de mort, et par celle de son arrière-petitefille, une jeune femme que la vie moderne bouscule, cinq générations parlent. Face aux duretés de la vie, face à la mort qui sème la zizanie, leurs histoires transmettent une gaieté indéfectible.
Un premier roman, un récit court qui traverse le siècle, réussite rare de vigueur et de simplicité.
« Chère Fanny,
C’est un beau et juste texte, et d’une gaieté étrange, qui tient, je crois, à la façon dont vous rendez le bonheur d’être chez quelqu’un qui n’a pas été gâté en bonheur de vivre. »
Daniel Pennac
Editions Flammarion
Des livres pour aider les enfants à surmonter un deuil
Le petit livre de la mort et de la vie
Les enfants, comme tous les êtres humains, s’interrogent sur les grandes étapes de la vie, de la naissance à la mort, qu’ils soient ou non confrontés à un deuil. Or, pour dénouer des sentiments d’angoisse ou de tristesse, rien ne remplace la parole et le dialogue. Avec des mots justes et sans se dérober devant des questions difficiles, ce petit guide veut apporter de l’espoir et expliquer que la mort fait partie de la vie et lui donne son sens. Les illustrations pleines de tact et d’humour aident autant que les mots à réfléchir et à comprendre.
C’est quoi la mort ?
Quand Piccolo revient de l’école, sa petite chatte Bergamote ne pointe pas le bout de son nez. Elle est allongée sur le lit, immobile, et Piccolo prend peur :
– Maman, Maman… Bergamote est morte !
Bergamote n’est pas morte, elle est juste patraque. Mais c’est l’occasion pour Piccolo de poser les questions qui lui trottent dans la tête, et pour sa maman de lui parler délicatement de la mort…
En fin d’ouvrage, « l’atelier philo de Piccolo » aborde différemment certaines interrogations soulevées par l’histoire et permet des échanges en famille.
Papa on ne t’oubliera pas
Cet album, traduit de l’allemand, est le récit authentique, par Marie, treize ans, de la maladie et de la mort de son père, sous forme d’un journal qu’elle a illustré de ses propres dessins. Le texte évoque de façon simple, sans fioritures, l’annonce du cancer, puis la chute des cheveux, l’angoisse d’aller rendre visite à son père à l’hôpital… et la vie qui ne sera plus jamais la même après sa mort, mais qui continue.
Les illustrations aux crayons de couleurs suivent fidèlement le texte et parlent d’elles-mêmes. On devine que ce récit a permis à cette jeune fille de faire le deuil de son père et aussi d’honorer sa mémoire, comme l’évoque le titre de l’album. Un récit simple et touchant qui aborde sans tabou le douloureux sujet de la mort d’un proche.
Un noeud à mon mouchoir
Un album qui aborde le chagrin d’un petit garçon, désarmé face à la mort de son grand-père. Heureusement, il y a les bons souvenirs et la complicité inoubliable avec un grand-père unique. – Un album au thème fort qui traite de la mort et du chagrin qu’un enfant peut éprouver lorsqu’il y est directement confronté. Le petit garçon au centre de ce récit est accablé de la perte de son grand-père et n’arrive pas à faire face à ce triste événement. – Cette histoire aborde ce thème délicat avec une grande subtilité, répondant ainsi aux questionnements récurrents que se posent les enfants face au mystère et l’inconnu que représente la mort. « C’est quoi la mort ? », « Comment fait-on pour mourir ? », « Est-ce que ça fait mal ? » : autant d’interrogations auxquelles ce livre tente d’apporter des réponses en filigrane, en évitant tout didactisme. L’auteur, pour écrire cette histoire, semble avant tout s’être mis dans la peau d’enfant, perplexe devant la mort de son grand-père adoré. – Le ton du récit, le choix des mots, les temps de silence qui semblent s’imposer entre chaque page, apportent ainsi le reflet fidèle d’une émotion d’enfant face à ce drame. Le petit garçon de l’histoire nous emmène avec lui au fil de ses pensées, de ses souvenirs, ce qui donne lieu à des associations d’idées touchantes : la vue du cercueil que l’on va enterrer lui rappelle les après-midi sur la plage où il jouait avec son grand-père à s’enterrer dans le sable jusqu’au cou… avant d’aller acheter une glace. Ce même petit garçon se demande également pourquoi les grands présents à l’enterrement, marchent aussi lentement, eux qui courent tout le temps… – Cet album n’est pas noir ni fataliste : il évoque le chagrin, bien sûr, mais célèbre surtout le souvenir des bons moments, des jeux complices, des goûters en cachette, des découvertes… autant de petits bonheurs qui font chaud au coeur et permettent de dépasser la douleur. Aussi, la conclusion du petit garçon est-elle que son grand-père est vraiment « inoubliable » !
Le vieux roi en son exil
Arno Geiger
‘Voici à peu près comment je me représente la démence en cette phase moyenne où mon père se trouve en ce moment : c’est comme si l?on vous arrachait au sommeil, on ne sait pas où l?on est, les choses tournent autour de vous, les pays, les êtres, les années. On s?efforce de s?orienter mais l?on n?y parvient pas. Les choses continuent de tourner, morts, vivants, souvenirs, hallucinations semblables à des songes, lambeaux de phrases qui ne vous disent rien ? et cet état ne cesse plus du reste de la journée.’ Arno Geiger part à la rencontre de son père, en essayant de jeter un pont vers cet état de démence dans lequel ce dernier est plongé depuis des années. Le récit de ce chemin parcouru ensemble est d?une sobriété et d?une poésie bouleversante. Car le romancier autrichien parvient non seulement à nous parler de l?homme que son père était avant ? un très jeune soldat précipité sur le front de l?Est à la toute fin de la guerre, un mari insensible aux envies de changement de sa jeune épouse, un employé de mairie sans fantaisie et un père de famille autoritaire ? mais aussi de ce quotidien que toute la famille doit réinventer autour de l?absence. La mémoire s?effrite, les repères se brouillent, et August Geiger est parti en exil. Son fils va essayer de le retrouver, de le comprendre, même si la raison ne peut plus lui servir de guide. Au bout du compte, il réinvente son père, et par la grâce d?une écriture oscillant avec beaucoup de justesse entre gravité et humour, son récit reconstitue au plus près ce lien que la maladie d?Alzheimer et autres démences arrachent aux familles. Le vieux roi en son exil est un de ces livres trop rares qui marquent le lecteur à jamais.
Vivre en mourant
Christopher Hitchens
En 2010, à 62 ans, Christopher Hitchens apprend qu’il est atteint d’un cancer. L’écrivain et journaliste, polémiste contemporain le plus connu des Etats-Unis, ne vivra que quelques mois.
Il avait passé sa vie à écrire, dans des livres et pour les journaux, sur la religion, sur les conflits internationaux, sur la politique américaine. Il était considéré tantôt comme un néoconservateur (après sa prise de position en faveur de la guerre en Irak) tantôt comme un représentant de la gauche «anti-totalitaire» —cet admirateur d’Orwell lui-même se disait de gauche.
Durant ses derniers mois, cet athée virulent écrit sur sa maladie et publie notamment un récit détaillé de son «combat» contre le cancer dans Vanity Fair. Ce texte inspirera Mortality, publié en 2012 de façon posthume, et qui paraît en France ce 11 septembre chez Flammarion, sous le titre Vivre en mourant. Ce livre ressemble aux textes qu’Hitchens publia de son vivant: ironique, vif, intelligent. Slate.fr en publie en exclusivité quatre extraits.
Au pays de Tumeurville
La nouvelle contrée est fort accueillante, à sa manière. Tout le monde sourit d’un air encourageant et l’on ne note absolument aucun racisme. C’est un esprit égalitaire qui prédomine et ceux qui gèrent cet endroit s’y sont manifestement trouvés du fait de leurs mérites et en travaillant dur.
En revanche, l’humour est un tantinet faible et répétitif, apparemment il n’est presque pas question de sexe, et la cuisine est la plus mauvaise que m’aient jamais fait connaître mes voyages. Le pays a une langue qui lui est propre – un idiome qui s’arrange pour être à la fois terne et ardu, et qui contient des noms comme ondansetron, pour un médicament contre la nausée – et puis aussi des gestes qui requièrent un peu d’accoutumance. Par exemple, un responsable que vous voyez pour la première fois peut brusquement vous enfoncer ses doigts dans le cou.
C’est comme ça que j’ai découvert que mon cancer s’était étendu à mes ganglions lymphatiques et que l’une de ces disgracieuses beautés – située sur ma clavicule droite – était suffisamment grosse pour se voir et se sentir. Ce n’est pas bon du tout quand votre cancer est «palpable» de l’extérieur. En particulier lorsque, à ce stade, ils ne savent même pas où se trouvait sa source primaire. Le carcinome agit avec ruse de l’intérieur vers l’extérieur. Détection et traitement procèdent, de façon plus lente et tâtonnante, de l’extérieur vers l’intérieur. De nombreuses aiguilles furent enfoncées dans la région de ma clavicule – «l’issue est le tissu» étant un grand slogan dans le langage local de Tumeurville – et je fus informé que les résultats de la biopsie pourraient demander une semaine.
En partant des squameuses cellules cancéreuses qu’identifièrent ces premiers résultats, il fallut nettement plus de temps pour découvrir la désagréable vérité. Le mot «métastase» fut, dans le rapport, celui qui accrocha d’emblée mon œil, et mon oreille. L’intrus avait colonisé un bout de mon poumon aussi bien qu’un bon bout de mes ganglions. Et la base d’où partaient ses opérations était située – avait été située depuis pas mal de temps – dans mon œsophage. Mon père était mort, et assez rapidement, d’un cancer de l’œsophage. Il avait soixante-dix-neuf ans. J’en ai soixante et un. À supposer que la vie soit une sorte de course, me voilà brutalement classé parmi les finalistes.
Le cancer, punition divine
Traitant la tumeur dans mon œsophage d’«étrangère aveugle et sans passion», je suppose que même moi je n’ai pu m’empêcher de lui attribuer certaines qualités d’une chose vivante. Cela, au moins, je sais que c’est une faute: un exemple de la tricherie sentimentale (nuage menaçant, montagnes fières, petit Beaujolais prétentieux) consistant à affubler de qualités propres aux êtres animés des phénomènes qui n’en sont pas. Pour exister, un cancer a besoin d’un organisme vivant, mais il ne peut même pas devenir un organisme vivant. Toute sa malignité – voilà que je recommence – réside dans le fait que le «mieux» qu’il puisse faire, c’est de mourir avec son hôte. Ou bien ça, ou bien son hôte trouvera les mesures permettant de l’extirper et de lui survivre.
Mais, comme je le savais avant de tomber malade, il y a des gens pour qui cette explication n’est pas satisfaisante. Pour eux, un carcinome rongeur est réellement un agent qui se consacre sciemment – en suicideur à action lente – à une mission sacrée du ciel. Vous n’aurez pas vraiment vécu – si je puis m’exprimer ainsi – tant que vous n’aurez pas lu des contributions comme celle-ci, sur les sites web des croyants:
Qui ne sent que le cancer mortel de la gorge [sic] qu’a Christopher Hitchens a été la vengeance de Dieu pour avoir utilisé sa voix à blasphémer contre Lui? Les athées aiment à ignorer les FAITS. Ils aiment faire comme si tout n’était que «coïncidence». Vraiment? Est-ce juste une «coïncidence» si, entre toutes les parties de son corps, Christopher Hitchens a eu un cancer dans celle qui lui a servi à blasphémer? Ouais, continuez à croire ça, athées! Il va se tordre de douleur dans les affres et se réduire à néant et puis mourir au terme d’une agonie horrible, et ALORS ce sera la vraie rigolade, quand il sera expédié dans le FEU DE L’ENFER pour y être à jamais torturé et brûlé.
Il y a de nombreux passages, dans les Écritures et la tradition religieuse, qui ont fait de ce genre de joie maligne un article central de la foi. Longtemps avant d’être personnellement concerné, j’avais compris les objections évidentes.
Premièrement, quel simple primate peut être aussi certain de connaître la pensée divine? Deuxièmement, cet auteur anonyme voudrait-il que ses opinions soient lues par mes inoffensifs enfants, qui vont à leur manière se voir infliger aussi une période très dure, et par le même Dieu? Troisièmement, pourquoi pas un éclair foudroyant en guise de «cordialement», ou quelque chose de semblablement terrifiant? La divinité vengeresse dispose d’un arsenal tristement restreint, si la seule idée qui lui vienne est précisément le cancer auquel on pouvait s’attendre chez moi, vu mon âge et mon «style de vie» antérieur. Quatrièmement, pourquoi le cancer, d’ailleurs? Presque tous les hommes ont un cancer de la prostate, s’ils vivent assez longtemps: c’est moche, mais c’est fort également réparti entre saints et pécheurs, croyants et mécréants.
Si vous maintenez que c’est Dieu qui décerne les cancers appropriés, il vous faut prendre aussi en compte les quantités d’enfants qui sont atteints de leucémie. De dévotes personnes sont mortes jeunes et en souffrant. Bertrand Russell et Voltaire, bien au contraire, sont demeurés pleins d’allant jusqu’au bout, comme l’ont fait aussi nombre de criminels psychopathes et de tyrans. Ces épreuves divines paraissent donc infligées terriblement au hasard.
Ma gorge pour l’instant non cancéreuse – laissez- moi m’empresser de l’assurer à mon correspondant chrétien ci-dessus – n’est pas du tout le seul organe à l’aide duquel j’ai blasphémé. Et même si ma voix disparaît avant moi, je continuerai d’écrire des polémiques contre les illusions religieuses, au moins jusqu’au moment du: bonjour, ténèbres, vieille amie. Auquel cas, pourquoi pas le cancer du cerveau? Une fois réduit à l’état d’imbécile terrifié et à demi conscient, il se peut même que je réclame à grands cris un prêtre, au moment de la fermeture; mais j’affirme ici, tant que je suis encore lucide, que l’être s’humiliant ainsi lui- même ne serait en fait pas «moi» (gardez ça à l’esprit, pour le cas de rumeurs ou falsification ultérieures).
La nécessité d’un «bref manuel de savoir-vivre en matière de cancer»
Depuis que j’ai été scié en pleine tournée de promotion d’un livre, pendant l’été 2010, j’ai adoré saisir toutes les chances de me rattraper et tenir tous les engagements que je peux. Débats et lectures font partie pour moi de la respiration de la vie, et j’aspire de grandes bouffées en toutes les occasions et tous les lieux possibles. Je prends aussi un réel plaisir à me trouver face à face avec vous, cher lecteur, que vous soyez ou non muni d’un reçu pour un rutilant nouvel exemplaire de mes mémoires. Mais voici ce qui m’est arrivé il y a quelques semaines. Imaginez-moi, si vous voulez bien, assis à ma table et voyant approcher une femme d’aspect maternel (type essentiel dans ma démographie):
ELLE: J’ai été désolée d’apprendre que vous avez été malade.
MOI: Merci de me dire ça.
ELLE: Un cousin à moi a eu un cancer.
MOI: Oh ! J’en suis vraiment désolé.
ELLE (tandis que la queue s’allonge derrière elle): Oui, du foie.
MOI: Ça n’est jamais bon.
ELLE: Mais c’est passé, alors que les docteurs lui avaient dit que c’était incurable.
MOI: Eh bien, c’est ce que tout le monde voudrait apprendre.
ELLE (les gens, au fond, commençant à manifester quelque impatience): Oui. Mais ensuite c’est revenu, et bien pire qu’avant.
MOI: Oh, Quelle Horreur !
ELLE: Et puis il est mort. Ça a été atroce. Atroce. Ça n’en finissait pas.
MOI (commençant à chercher mes mots).
ELLE: Bien sûr, il était homosexuel, depuis toujours.
MOI (ne trouvant pas de mots et ne voulant pas être assez bête pour répéter son «bien sûr»): …
ELLE: Et toute sa famille proche l’a renié. Il est mort pratiquement seul.
MOI: Eh bien, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais…
ELLE: En tout cas, je voulais juste vous dire que je sais exactementquelle épreuve vous traversez.
Ce fut une rencontre étonnamment épuisante, dont je me serais bien passé. Du coup, je me suis demandé s’il n’y aurait pas place pour un bref manuel de savoir-vivre en matière de cancer. Destiné aussi bien aux malades qu’aux sympathisants. Après tout, je n’ai guère fait mystère de ma maladie, mais je ne me promène pas non plus en arborant au revers de mon veston un badge marqué INTERROGEZ-MOI SUR LA PHASE 4 DU CANCER DE L’ŒSOPHAGE AVEC MÉTASTASES ET SUR RIEN D’AUTRE.
À dire vrai, si vous n’avez rien à m’apprendre sur ce sujet et sur lui seul, ni sur ce qui arrive quand les ganglions lymphatiques et le poumon sont atteints, je ne suis guère intéressé, ni compétent. On développe presque une espèce d’élitisme à propos de la singularité unique de sa maladie. Donc, si l’histoire que vous me racontez, qu’elle soit la vôtre ou de seconde main, concerne quelque autre organe, vous devriez envisager de me la rapporter succinctement, ou au moins de façon plus sélective.
Cette suggestion est valable aussi bien si l’histoire est extrêmement déprimante et mauvaise pour le moral – voir ci-dessus – que quand elle cherche à vous inspirer confiance et optimisme: «Ma grand-mère a eu droit à un diagnostic de mélanome terminal au niveau du point G, et elle était considérée comme perdue. Mais elle s’est accrochée, elle a pris d’énormes doses de chimio et de rayons, et la dernière carte postale que nous avons reçue d’elle venait du sommet de l’Everest.» Encore une fois, votre petite histoire risque de ne pas convaincre si vous ne vous êtes pas d’abord donné la peine de savoir où en est (ou comment se sent) l’auditeur visé.
Ce qui ne vous tue pas ne vous renforce pas
Je tape ceci juste après avoir eu une piqûre pour tenter de réduire la douleur dans mes bras, mes mains et mes doigts. Le principal des effets secondaires de cette douleur est l’engourdissement des extrémités, suscitant la peur, qui n’a rien d’irrationnel, de n’être plus capable d’écrire. Privé de cette capacité, je sens d’avance avec certitude que mon «vouloir vivre» serait considérablement réduit.
J’ai souvent dit pompeusement qu’écrire n’était pas seulement ce qui me donnait de quoi vivre et me donnait aussi de la vitalité, mais que c’était toute ma vie, et c’est vrai. Presque comme la menace de perdre ma voix, menace qui est à présent atténuée par quelques injections temporaires dans mes cordes vocales, je sens ma personnalité et mon identité se dissoudre quand j’envisage de me retrouver les mains mortes et de perdre les courroies de transmission qui me relient à l’écriture et à la pensée.
Ce sont des faiblesses progressives qui, dans une vie plus «normale», auraient mis des décennies à me rattraper. Mais, tout comme dans la vie normale, on trouve que chaque jour qui passe se présente de plus en plus comme inexorablement soustrait à… de moins en moins. En d’autres termes, le processus à la fois vous étiole et vous pousse en avant vers la mort. Comment pourrait-il en être autrement?
Au moment même où je commençais à réfléchir dans cette direction, je suis tombé sur un article concernant le traitement des troubles du stress intervenant après un traumatisme. Aujourd’hui, à la lumière d’expériences chèrement payées, nous en savons beaucoup plus sur cette maladie que nous n’en savions naguère. Apparemment, l’un des symptômes par lesquels elle se manifeste c’est qu’un ancien combattant dur à cuire dira, cherchant à voir clair dans ce qu’il a vécu: «Ce qui ne m’a pas tué m’a rendu plus fort.» C’est l’une des formes que prend le «déni».
Je suis intéressé par l’étymologie allemande du mot stark, et par le comparatif qu’utilise Nietzsche, stärker, «plus fort». En yiddish, dire de quelqu’un que c’est un shtarker, c’est le qualifier de militant, de dur, de gros travailleur. Pour le moment, j’ai décidé d’encaisser tout ce que ma maladie peut me balancer et de demeurer combatif même en prenant la mesure de mon inévitable déclin. Je le répète, ce n’est rien de plus que ce qu’a à faire une personne en bonne santé, à une vitesse moindre. C’est notre lot commun. Dans les deux cas, toutefois, on peut se dispenser de maximes faciles qui ne sont pas à la hauteur de ce qu’elles affichent.
Christopher Hitchens, Vivre en mourant, Flammarion, 128 p.
Avant le passage
François Emmanuel
Le roman, Avant le passage, de François Emmanuel, nous embarque dans une divagation qui nous emporte et nous déporte. Nous quittons les rives tranquilles de la platitude des jours et nous partons pour un voyage à risques. Avec le narrateur, nous sillonnons des eaux agitées. On ne peut s’empêcher d’avoir devant les yeux l’image de la barque d’Arnold Böcklin qui conduit vers l’Île des morts. Le narrateur nous le confirme en affirmant : « je dérive à nouveau sur le radeau lumière ».
Dans un espace coupé du monde, confiné, nous naviguons sans cesse entre deux eaux. Entre le blanc trop blanc des murs d’une chambre d’hôpital et l’obscurité très noire des pensées du narrateur qui erre aux marges du royaume des morts. Entre quelques rayons de soleil des souvenirs de pays lointains, de moments joyeux, émouvants, rappelés, et la nuit de l’adieu à l’aimée brutalement arrachée à la vie dans un bruit assourdissant de ferraille fracassée. Entre le fleuve des enfers de la réalité et la terre silencieuse de paysages coutumiers. Entre la joie d’une main posée sur un front comme une présence maternelle bienveillante qui réchauffe et la tristesse de l’enfermement dans un corps qui ne répond plus. Entre l’oppression vécue dans une rêverie inquiète et la liberté rêvée, dépliée comme un fil que l’on tire. Entre le temps dilaté et menacé de sombrer dans le gouffre ténébreux de l’oubli et le temps resserré, suspendu, qui défile à toute allure.
Entre des prénoms qui résonnent avec une phonétique qui parle à l’oreille comme l’appel d’une présence et des noms de lieux étranges qui fascinent comme l’évocation de tableaux incrustés dans la mémoire du narrateur et qui le hantent et nous émeuvent. Entre le corps souffrant et inquiet et l’esprit qui rêve à l’évasion du quotidien insupportable. Entre la proximité de « l’infini battement de la présence des choses » et l’éloignement inéluctable de la « trace perdue de la trace ». Entre l’espoir de retrouver un voile de vérité pour accueillir l’inespéré et de revenir par le souvenir « dans le vivant du monde » et le désespoir des déchirements et des meurtrissures d’un corps entamé et le risque du moment où la lumière quittera le chemin. Entre la tentative d’approcher la paix et l’abandon dans le brouillard et « l’ensevelissement dans le néant ». Entre « l’obsédant voyant rouge » qui rappelle l’imminence du danger et la tentative de sortir du tunnel et d’approcher la paix en rouvrant les portes du silence. Entre le vertige et la culpabilité vis-à-vis de l’amour perdu de Mia et l’amour retrouvé de Mary « dans une consolante volupté » offerte envers et contre tout au corps malade. Entre le refus de la fin et l’acception presque tranquille, presque apaisée, où tous les aimés sont rassemblés pour que le narrateur puisse marcher « avant le passage » « vers le blanc du porche ». Entre la limite du vécu présent et le sens illimité des mots.
Le roman de François Emmanuel, écrit à la première personne, est un long monologue qui fouille, entre prose et poésie, le mystère de l’existence, qui tente de rendre perméables les frontières d’éléments qui s’enchevêtrent, s’amalgament, s’alignent, et qui garde le tranchant d’une énigme non résolue comme dans un rêve. Le narrateur fait éclater le temps, l’immobilise dans le livre. Il nous contraint à errer à petits pas, sans faire de bruit, aux confins de la vie et de la mort dans le labyrinthe de ses pensées comme Dédale dans le rébus du sens. Le Minotaure est bien là tapi et l’on se cogne aux mots, aux phrases infiniment longues sans ponctuation autre qu’une virgule posée à des endroits du texte où l’auteur nous appelle au suspens d’une respiration ou à une coupure franche, une césure entre caractères en italique de la réalité et écriture droite de la remémoration. Cette typographie donne au texte une scansion spécifique, le rythme d’une fugue.
Quand, contre notre volonté, le texte se clôt, on souhaiterait continuer à écouter cette langue musicale où défilent et s’enfilent les associations d’idées comme dans une séance d’analyse. Mais l’on sait pourtant que le point final exigera de nous, lorsque nous refermerons le livre, qu’advienne le moment inéluctable de la séparation. Seuls resteront en nous des images, quelques tracés de lumière, une intériorité, une sensibilité, une émotion, portés par une voix singulière qui enrichiront notre pensée. N’est-ce pas cela l’essentiel que l’on peut espérer d’un texte ?
David, les femmes et la mort
Judith Vanistendael
Un roman graphique poignant. Au moment où naît sa petite-fille Louise, David apprend qu’il a un cancer. Mais la parole n’a jamais été son fort, et il préfère taire la maladie, la douleur, et la fin qui se profile. Au grand dam des femmes de sa vie – sa femme Paula, ses filles Miriam et Tamar. Impuissantes, elles assistent à ce délitement silencieux, mais inexorable.
L’arbre généalogique qui ouvre l’album nous fait craindre une histoire complexe. En fait, il n’en sera rien. Quelques noms y figurent par pure formalité, et en se familiarisant avec l’univers de David, on se rend compte que celui-ci est finalement peu entouré. Toutefois, cet entourage –constitué uniquement de femmes, lui est bien plus proche que toute une armada frétillante mais détachée de parents éloignés. Il y a Tamar, la cadette, qui forme avec sa mère Paula la base du foyer de David, mais aussi Miriam, sa première fille, née d’une précédente union et à son tour mère d’une petite Louise.
David apprend qu’il a un cancer. « Un cancer du larynx supraglottique. de type T3 N26 M0. Cela veut dire que tu peux t’en sortir », lui annonce son médecin, qui est aussi un ami de longue date. La nouvelle le bouleverse, évidement, et suscite des visions funèbres que Judith Vanistendael transpose sur plusieurs pages de superbes aquarelles. Mais il en parle peu, et ce sont ses femmes qui viennent prendre le relais, exprimant chacune à leur façon la tristesse et la colère qu’il est légitime d’éprouver dans une telle situation.
Le découpage en plusieurs parties –une consacrée à Miriam, l’autre à Tamar, une autre à Paula, et la dernière à David- permet d’étayer le point de vue sur la maladie et de faire une incursion dans la psychologie de chaque personnage, engendrant par la même occasion la réflexion sur les différentes façons de réagir face à un même évènement en fonction de l’âge, du statut social, mais aussi du caractère et du vécu propres. Cette incursion dans chaque personnage permet également de mettre en valeur le gouffre qui peut exister entre la vie intérieure et son extériorisation. David, qui semble si résigné, est en réalité presque fou à l’idée de sa mort prochaine. De même, Paula, qui décide de partir en Suède pendant cinq jours, laissant David et Tamar seuls à la maison, pourrait sembler cruelle si nous ne connaissions pas la terreur qui est la sienne à l’idée de perdre David et de se retrouver seule.
La manière d’aborder la mort dans cet album ne cherche pas à faire dans le grandiloquent. Les sentiments qui lui sont liés sont traités avec tout le naturel qui sied à cette situation elle-même naturelle. Finalement, ce léger détachement permet d’évoquer le cancer de David avec sérénité. On pourrait même parler d’un tragique heureux dans le sens où, personne n’ignorant la mort prochaine de David, tout le monde essaie de vivre au mieux et avec le plus d’intensité les derniers moments en sa compagnie… avec plus ou moins de succès.
Arriver à susciter l’apaisement alors même que les situations exigeraient plutôt qu’on se laisse complètement aller au désespoir n’est pas évident. Toutefois, David, les femmes et la mort réussissent à mener une danser qui y parvient parfaitement.
Les murmurantes
François Emmanuel
Un homme revient sur les traces d?une femme qu?il a aimée quelques années auparavant, dans une Inde rêveuse, crépusculaire, énigmatique. Dans un hôtel de Cagliari, un marchand d?art provoque un rendez-vous avec l?amant de sa femme morte brusquement à 46 ans. Un lien inattendu se noue entre eux autour d?une dormition de la Vierge exécutée par un maître de la Renaissance italienne. Un grand écrivain de langue espagnole vient de mourir. Dans la maison qu?il occupait, sur une île, et au milieu des querelles d?héritage (la fille aimée, sa belle-mère haïe, l’agent littéraire, les journalistes), le secrétaire du grand homme dévoile le lien particulier qui les unissait : qui, de celui qui dictait ou de celui qui recueillait cette parole, écrivait vraiment ? Trois nouvelles amoureuses qui, chacune à leur manière, donnent la mesure du talent de François Emmanuel : une prose subtile et sensible, des personnages et des thèmes qui se croisent, s’appellent et se répondent, pour faire de ce recueil un livre à part entière, une variation à trois voix sur l’objet perdu du désir.
La langue de ma mère
Tom Lanoye
Digne successeur de Hugo Claus dans son célèbre Chagrin des Belges, il allie un regard sarcastique sur la société flamande avec une tendresse ironique et lucide.
En souvenir d’André
Martin WINCKLER
Un roman humaniste!
Un homme en fin de vie nous raconte comment, plus jeune, il a accompagné dans la mort des malades qui se savaient condamnés… Un roman magnifique qui aborde le thème délicat de l’euthanasie à travers des confessions bouleversantes qui nous plongent au cœur de l’âme humaine. Une écriture limpide et chargée en émotion!
“Je vais d’abord m’occuper de la douleur”
Un ancien médecin raconte comment il a aidé des gens à mettre fin à leurs souffrances et de quelle façon cette pratique l’a atteint. Il parle des derniers secrets confiés, des derniers instants vécus. Winckler traite ici avec justesse un sujet actuel et épineux,le droit d’aider les autres à mettre fin à leur vie
Plaidoyer subtil et émouvant en faveur du droit de chacun à choisir une mort digne et sans souffrance, ce livre est à lire absolument, quelles que soient nos convictions!
La maternité
Qu’en ressort- il? Non pas un simple témoignage, mais une sorte de combat avec les mots dits et les mots écrits autour d’une mort annoncée
“Histoires de proches” face à la maladie, 35 récits de vie, chez Jacob Duvernet
Des liens d’exception entre joie et peine
 Ils s’appellent Joëlle, Georges, Paule, Nicole, Françoise, Laurent … Tous ont vu leur vie bouleversée par l’intrusion de la maladie chez un être cher.
Ils s’appellent Joëlle, Georges, Paule, Nicole, Françoise, Laurent … Tous ont vu leur vie bouleversée par l’intrusion de la maladie chez un être cher.
Aux côtés de leur mari, leur femme, leur père, leur mère, leur enfant ou leur frère frappé par le cancer, la maladie d’Alzheimer ou de Parkinson, la sclérose en plaques …. Ils ont dû affronter une épreuve à laquelle rien ne les préparait. Face aux fondements de leur vie qui s’effondrent, alors que l’être aimé se bat pour rester en vie, les uns et les autres vont apprendre à réinventer leur quotidien, à gérer leurs sentiments d’impuisance, de lassitude, de culpabilité et d’isolement.
Pour la première fois des proches se livrent et racontent le lien d’exception qui les unit à l’autre, entre joie et peine, espoir ou renoncement. Derrière ces récits bouleversants se cachent de véritables histoires de vie, des magnifiques histoires d’amour.
35 portraits dans lesquels chacun de nous pourrait se reconnaître.
« Un bouleversant message d’amour », écrit dans sa préface Eric Emmanuel Schmitt, “J’ai beaucoup appris en lisant ces textes ; j’ai même appris une chose si simple et pourtant si difficile : être un homme. »
Tous les textes de cet ouvrage sont issus du concours « Histoire de proche » organisé en 2009 par France Alzheimer, France Parkinson, la Ligue contre le cancer, la Ligue Française contre la sclérose en plaque et Novartis Pharma.
J’ai réussi à rester en vie
Joyce Carol Oates
Le fils
Michel Rostain
Le onzième jour après ma mort, Papa est allé porter ma couette à la teinturerie. Monter la rue du Couédic, les bras chargés de ma literie, le nez dedans. Il se dit qu’il renifle mon odeur. En fait, ça pue, je ne les avais jamais fait laver ces draps ni cette couette. Ça ne le choque plus. Au contraire : subsiste encore quelque chose de moi dans les replis blancs qu’il porte à la teinturerie comme on porterait le saint sacrement. Papa pleure le nez dans le coton. Il profite. Il sniffe encore un coup la couette, et il pousse enfin la porte du magasin.
Papa ne peut plus traîner. Condoléances, etc. Le teinturier ¬recondoléances, etc. ¬ débarrasse papa de la couette. Papa aurait voulu que ça dure, une file d’attente, une livraison, une tempête, juste que ça dure le temps de respirer encore un peu plus des bribes de mon odeur. Papa se dépouille, il perd, il perd. »
Michel Rostain nous happe dans le récit d’un deuil impensable. Avec une infinie pudeur et une grande finesse, il nous entraîne dans les méandres d’un amour absolu, celui d’un père pour son fils.
Michel Rostain vit à Arles. Né en 1942, metteur en scène d’opéras, il a dirigé la Scène nationale de Quimper ¬ Théâtre de Cornouaille ¬ de 1995 à 2008.
« Dans ce livre totalement singulier, Michel Rostain parvient à dire l’indicible, à penser l’impensable, à cerner avec délicatesse un événement monstrueux : la disparition brutale d’un enfant adulte. Je l’ai lu six fois. À chaque fois j’ai pleuré. Plus étonnant, à chaque fois j’ai ri. Et à chaque fois je l’ai refermé en éprouvant une immense gratitude envers l’auteur, d’avoir su nous faire ressentir la beauté de l’amour, la manière miraculeuse dont elle nous enrichit, par-delà le deuil. »
Nancy Huston
« Le Fils est un torrent de vie, d’humour noir et d’amour qui déborde et fait comprendre comment on peut, malgré tout, vivre avec « ça ». »
Le fils Michel Rostain Le Livere de poche
Accabadora
Michela Murgia
Ici le vin ici est noir. Il faut vraiment qu’un plein soleil touche le verre pour qu’on puisse apercevoir en transparence une lueur rubis transperçant l’hématite. Une goutte de sang noyée dans l’encre chaude. On le boit sans parler. Qu’aurait-on à dire, d’ailleurs, tant la vie que l’on mène ressemble aux précédentes ? A ces générations dont on ne sait plus bien quand elles ont commencé.
C’était il y a longtemps. Rien n’a vraiment changé à Soreni, ce village de Sardaigne. De toute éternité. Nous sommes dans les années 1950. Deux guerres ont passé comme un souffle. Les hommes peuvent bien mourir, les femmes leur survivent. Faisant du noir des deuils une couleur d’habitude. Noir encore, noir toujours. Comme pour empaqueter les années les unes après les autres. Surtout ne rien laisser paraître des chagrins, des désirs, des peurs, des espérances. Ou si peu. Presque rien.
Accabadora, le premier roman de Michela Murgia, est un livre habité de secrets, de prières, envahi doucement par le chuchotement des âmes. Fill’e anima, fille d’âme, voilà justement le nom que l’on donne à Maria depuis qu’à ses 6 ans sa mère l’a définitivement “confiée” à Bonaria Urrai, la couturière veuve, sans descendance et sans âge.
Maria est de ces “enfants doublement engendrés, de la pauvreté d’une femme et de la stérilité d’une autre”. Singulier marchandage. Mais la fillette s’est vite apprivoisée. “Habituée à être le cadet des soucis d’une famille qui n’en avait que trop (…), elle expérimentait auprès de Tzia Bonaria la sensation insolite d’être importante.” Elle découvre, à mots rares, dans son foyer d’adoption une tendresse nouvelle qui lui apprend à grandir à son heure. Sauf qu’elle s’aperçoit, sans rien qu’on veuille lui expliquer, que parfois il arrive à Bonaria de s’absenter la nuit.
Elle a beau tenir à l’écart le mystère, s’efforcer de ne pas céder à la curiosité, une part de la vie de celle qui l’a recueillie lui échappe et lui est étrangère. En fait, la veuve est l’accabadora de Soreni, “la dernière mère” qui aide les mourants à franchir le dernier seuil. On l’appelle pour faire passer les vieillards, les malades, accrochés malgré eux à un douloureux semblant de vie. Singulier sacerdoce.
Sur le versant obscur où personne ne se hasarde, elle est celle qui, tragiquement, libère. La Sardaigne que décrit Michela Murgia se révèle effrayante de sorts jetés et de superstitions. On y prête aux araignées des pouvoirs maléfiques, on emmure des chiots vivants, et l’on ôte, aux heures ultimes, les crucifix et les statues des saints des chambres des agonisants.
Magnifique, ce roman lent du silence, du poids du silence, est aussi une troublante histoire de filiation, de transmission. “Mon ventre ne s’est jamais ouvert et Dieu seul sait combien je l’aurais voulu, explique Bonaria à Maria, désemparée, qui la presse de questions. Mais je n’ai eu besoin de personne pour apprendre qu’il faut donner à ses enfants des gifles, des caresses, le sein, le vin de la fête et tout ce qui est nécessaire quand cela est nécessaire. J’avais, moi aussi, mon rôle à jouer, et je l’ai joué.”
Remarquablement traduit par Nathalie Bauer, Accabadora est un texte de la révélation. La vie et la mort appartiennent aux femmes. Entre le monde ancien et celui qui s’annonce, chargé d’une inquiétante modernité, Michela Murgia raconte avec une pudeur de chaque phrase comment une toute jeune fille va pouvoir à son tour affronter son destin.
ACCABADORA de Michela Murgia. Traduit de l’italien par Nathalie Bauer. Seuil, 214 p., 17 €.